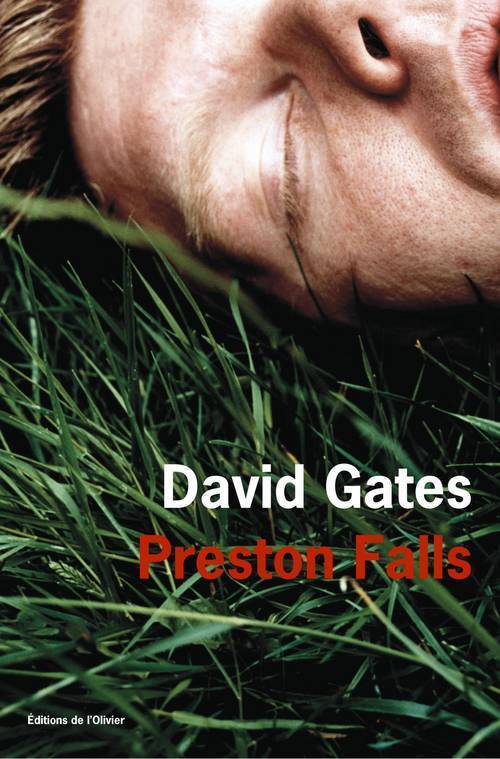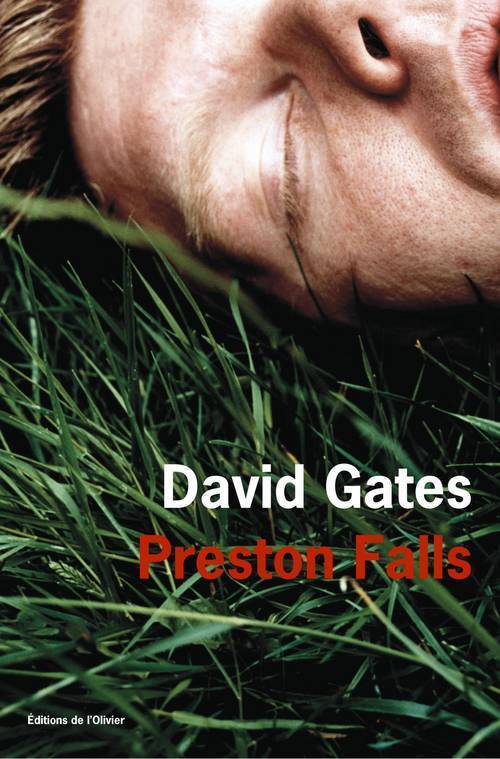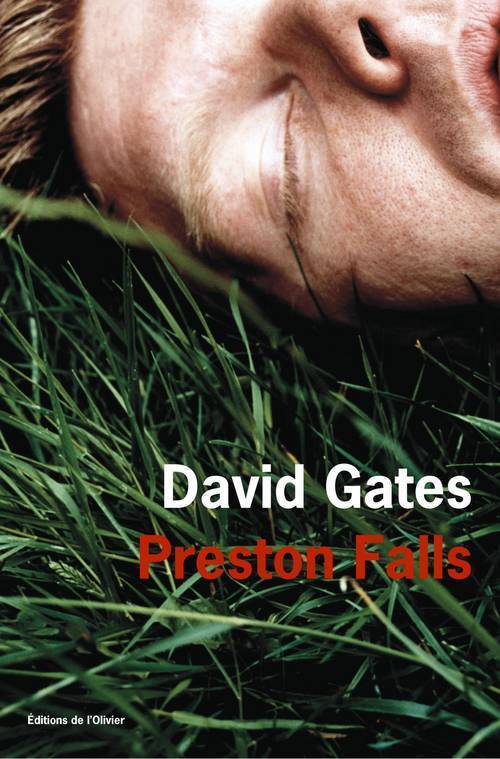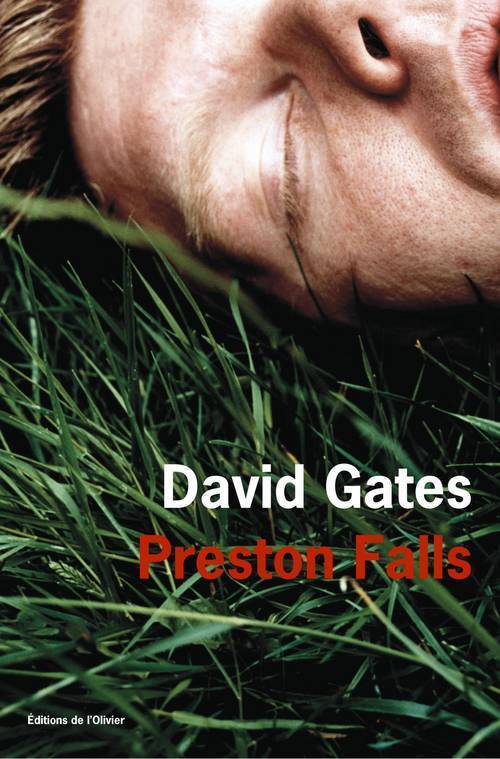Doug Willis (marié, deux enfants) possède une maison de campagne au nord de New York, à Preston Falls. Sous prétexte d’effectuer des travaux, Willis prend un congé sabbatique et s’y installe pour deux mois, seul. Tel est le point de départ de cet étonnant roman « existentiel », portrait d’un anti-héros et récit d’un naufrage conjugal.
Willis est un loser, et il le sait. Sa famille aussi. Cela ne l’empêche pas de glisser lentement vers un échec annoncé, de se laisser aller à des comportements régressifs ou légèrement asociaux, à des accès de déprime, à des fréquentations qui ne sont plus vraiment de son âge.
Si l’art du roman vise à l’élucidation d’une vie, Gates s’y montre un virtuose, dans une veine naturaliste qui procède par accumulation de détails vrais et de dialogues d’une justesse absolue. Lecteur forcené de Dickens et de Jane Austen, Doug Willis découvre par hasard le grand roman mystique et allégorique de John Bunyan, The Pilgrim’s Progress, et en fait son livre de chevet. L’allusion est transparente : il faut lire Preston Falls comme le récit d’une rédemption morale qui ne parvient pas à son terme. Mais le plus surprenant tient au rôle joué par Jean, la femme de Willis. Au milieu du roman, Willis disparaît. Désormais, le récit se poursuit du point de vue de Jean, et c’est une autre histoire, complexe, nuancée, douloureuse.
Ce roman magnifique est celui d’un « retournement » : comme si David Gates faisait pivoter sur son axe une tranche d’american way of life pour nous en révéler l’envers. Une réussite littéraire comparable à celle que furent, il y a vingt ans, les grands romans de John Updike.
Traduit de l'anglais (États-Unis) par Francis Kerline.